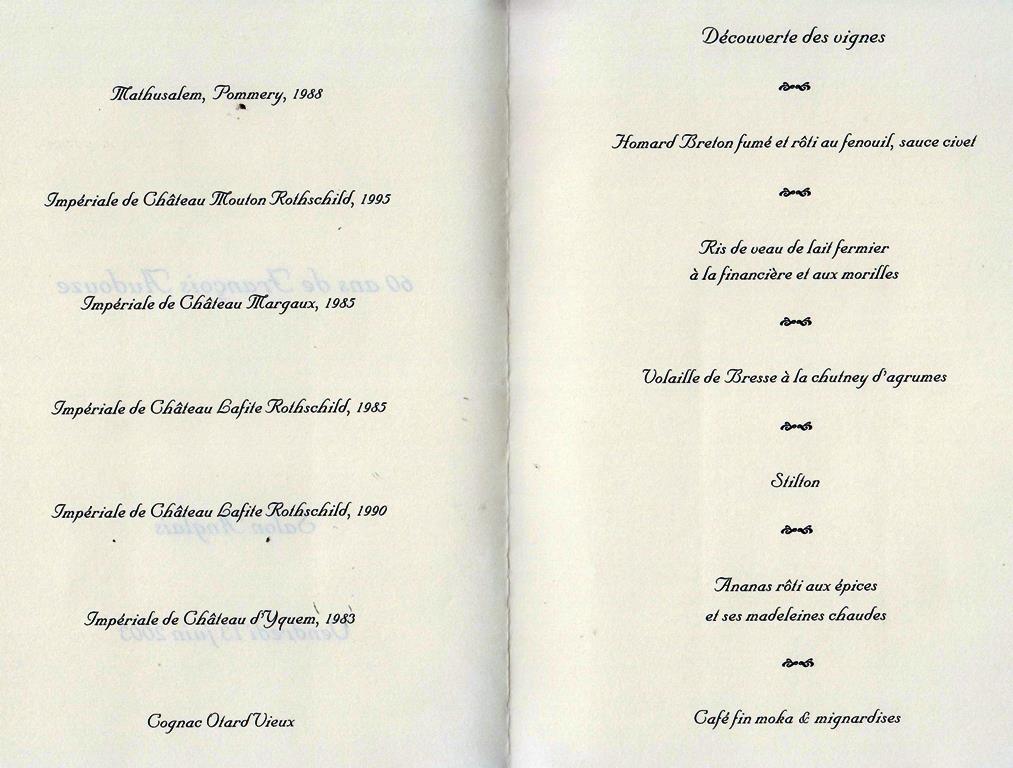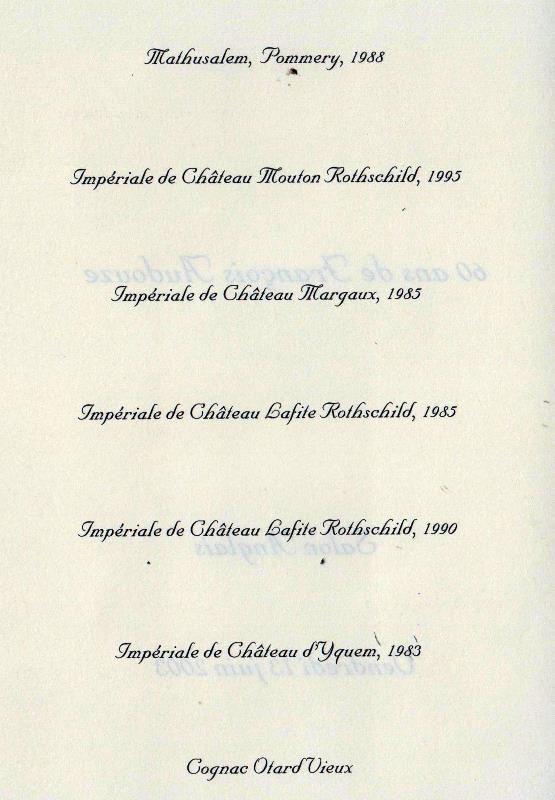Je rencontre pour déjeuner Bipin Desai, l’un des plus grands palais du monde, qui a tout bu, même l’inimaginable, et a tout retenu. Il m’entraîne au restaurant Hiramatsu, où nous prenons le menu dégustation. Quelle découverte !
Les saveurs ont des précisions diaboliques, ciselées comme les définitions d’un dictionnaire, mais surtout, chaque saveur d’accompagnement forme un tableau pastel où tout est justifié. C’est une cuisine en suggestions magiques, en évocations subtiles, où le mets de base du plat est mis à l’honneur avec respect. Les lobes de foie gras glissent comme du beurre fondant, le rouget danse dans la bouche. C’est une cuisine d’un esthétisme rare. Le champagne de Souza brut tradition a beaucoup plu à Bipin, mais malgré sa belle sécheresse, je n’ai pas tant vibré. Le Corton Charlemagne Bonneau Du Martray 1992 mérite le respect. Grand vin, grande année. Un nez puissant, de belles choses à raconter. Sur le homard à peine cuit, ça sonne bien, mais je l’ai dix fois préféré sur le foie gras au chou. Là il excite le palais. Fort judicieusement le très compétent sommelier a apporté Le Vosne Romanée Cros Parantoux Rouget 1989 sur le rouget, à cause de la sauce au chocolat qui collait si bien à ce vin parfumé de café et de chocolat. Nous allons boire ensembleavec Bipin dans quelques jours le même vin de Rouget en 1990. Si on peut en attendre plus de puissance, j’ai particulièrement apprécié la légèreté aérienne de ce vin extraordinairement délicat, qui collait comme il convient avec une sensualité d’esthète à cette cuisine si richement évocatrice de sensations neuves. Un grand moment de saveurs excitantes. On sent une équipe qui piaffe et cherche un local digne de ses ambitions. S’ils persistent dans cette motivation tellement apparente, on peut attendre comme pour l’Astrance, d’y trouver la voie de la cuisine de demain. Les évocations sont discrètes, suggérées, et là où le charme agit, c’est qu’elles sont justifiées.